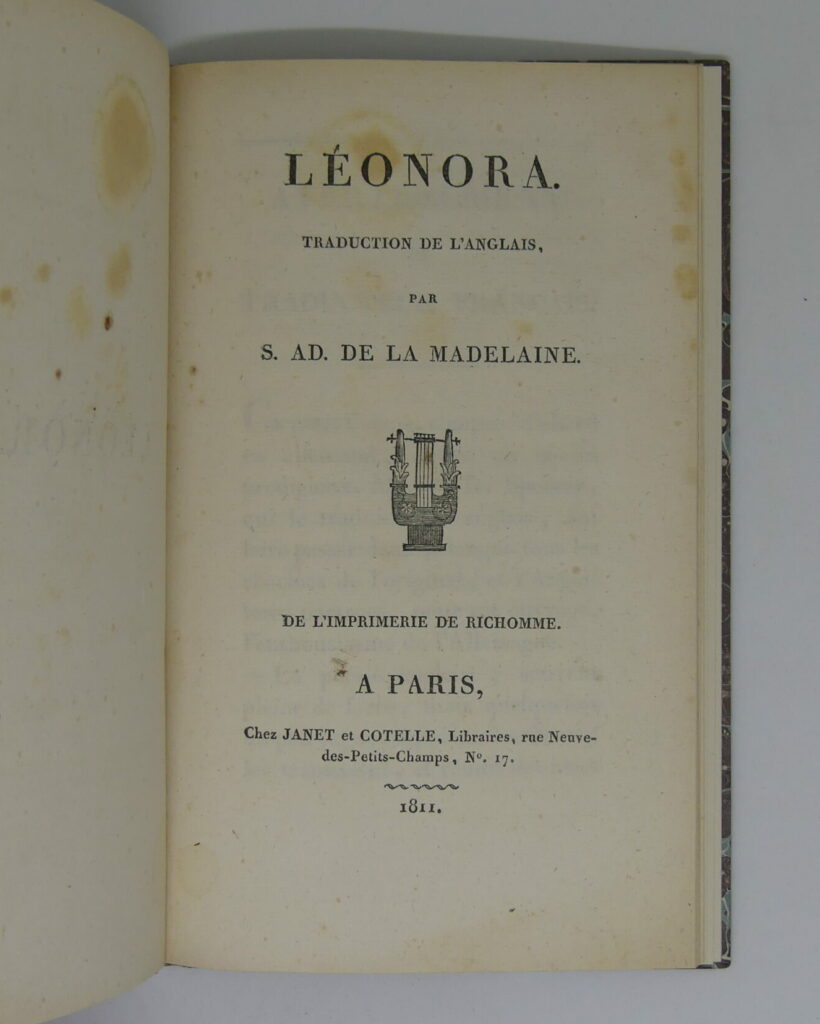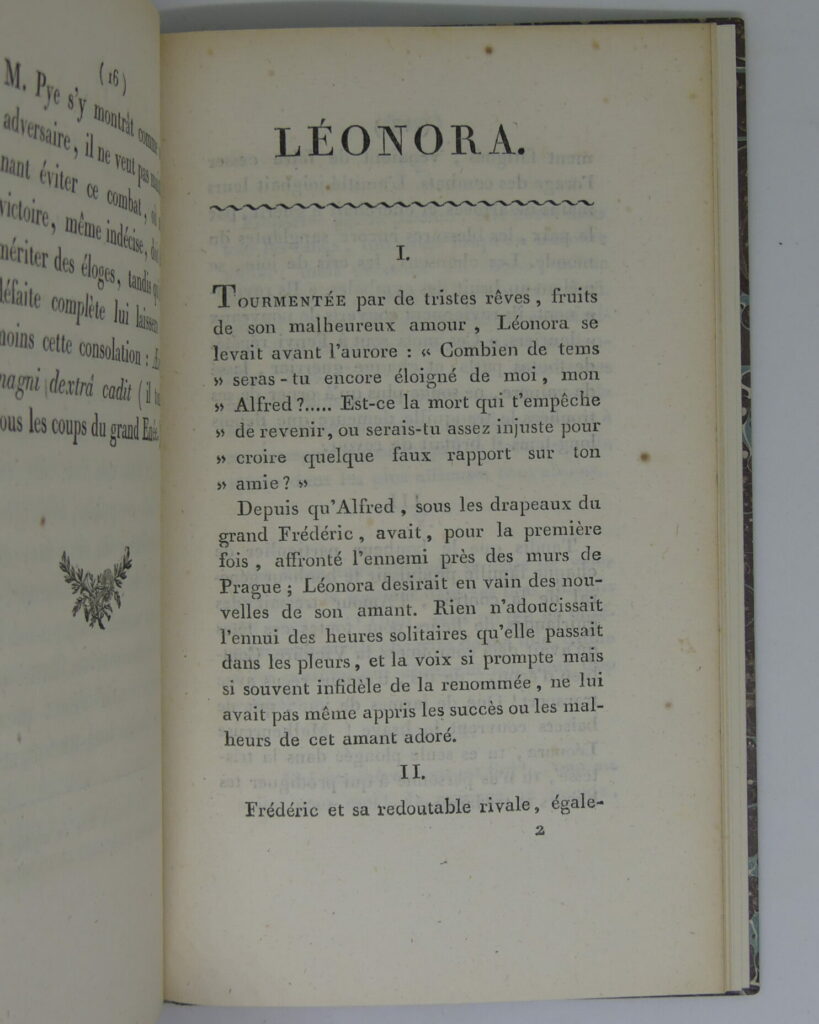BÜRGER (Gottfried August). Léonora. Traduction de l’anglais, par S. AD. DE LA MADELAINE. Paris, Chez Janet et Cotelle, 1811. In-8, cartonnage moderne Bradel, titre en long (Goy et Vilaine). 37 pages et 1 ff blanc. 201×123 mm. Petit manque de papier au dernier feuillet (blanc). Quelques rousseurs sur les trois premiers feuillets (surtout au faux-titre).
réservé
Les prémices de la littérature vampirique et du fantastique*.
Edition originale française de ce poème paru en 1773 ; elle est établie à partir de la traduction anglaise de W. R. Spencer (1796). Elle paraît très rare.**
« Les montagnes et les forêts, les villes, les villages et les châteaux disparaissent aux yeux de Léonora avec une rapidité que ne peut plus soutenir sa vue fatiguée. / […] As-tu peur mon amie ?… Hâtons-nous : la lune brille encore de tout son éclat ; mais bientôt les morts, échappés des tombeaux, vont y rentrer, effrayés par l’approche du jour. Leurs mânes errans t’inspirent-ils de l’effroi ? / Léonora : Ah laisse, laisse en paix les morts ! / Au milieu de ces herbes sauvages toutes dégoûtantes de sang, voyez cette roue présenter ses pointes encore fumantes aux cadavres sans sépulture des meurtriers […]. Leurs fantômes hideux forment à l’entour d’effroyables danses, auxquelles la lune, à moitié voilée, prête avec peine son pâle flambeau. »
Dans cette belle ballade très représentative du mouvement Sturm und Drang, Léonora est une jeune femme qui attend le retour de son fiancé, parti à la guerre. Tous les hommes reviennent, sauf lui. Désespérée, hors d’elle, elle blasphème, déclare à sa mère qu’elle aimerait mieux descendre dans la tombe. Alors, un cavalier qu’elle croit être celui qu’elle aime, arrive et l’emmène…
F. Baldensperger estimait que ce poème dans lequel le Journal des Débats du 8 avril 1811 « ne manqua pas de discerner “les vices les plus odieux de l’école germanique” » possédait « ce qu’il fallait pour plaire à cette génération [française] des alentours de 1820, lasse des poétiques traditionnelles, qui cherchait avec tant d’incertitude et de fièvre des modèles à son goût. » Madame de Staël, qui l’appréciait beaucoup, le jugeait à peu près intraduisible, mais il connut au moins trente versions françaises en vers ou en prose, au XIXe siècle. Gérard de Nerval en proposa cinq.
Cette ballade où « émerge véritablement le personnage de l’amant ténébreux, surgi du néant pour chercher sa bien-aimée » (D. S-H.) est indissociable de l’histoire du vampire littéraire dont elle constitue une étape notable, quoique le fiancé de Léonora, ne puisse être considéré comme l’un de ces morts-vivants.
La première œuvre connue de littérature vampirique est l’intéressant poème d’Ossenfelder, Der Vampir, paru en 1748. Il s’agit toutefois d’une œuvre de circonstance : le directeur de la revue scientifique dans laquelle il figure avait coutume d’illustrer certains des sujets traités – dans le cas présent, le début de la traduction de la lettre juive de Boyer d’Argens sur les vampires – par des pièces littéraires. (cf Stefan Hock). Ce court texte où évolue non pas un mort-vivant, mais un amant éconduit, où est déjà mise en avant la symbolique sensuelle du baiser mortifère du vampire, indissociable de l’image que l’on se fait aujourd’hui du vampire (et qui, à l’instar de toute autre forme d’érotisme, est totalement absente des légendes paysannes serbes), ne fera pas école, au moins dans l’immédiat. Il faudra en effet attendre de très nombreuses années pour que naisse le thème littéraire, pour que des revenants inspirés par ceux des événements serbes se mettent à fleurir dans les productions littéraires. L’étape sera franchie en 1819 avec The Vampyre de l’Anglais Polidori, mais avant cela de timides premiers pas seront faits en poésie, d’abord en Allemagne avec, justement, le poème de Bürger, puis, plus de vingt ans après, La Fiancée de Corinthe, de Goethe (1797).
C’est Léonora qui eut la plus grande influence sur les romantiques anglais. Précédée il est vrai par une certaine évolution littéraire incluant la « poésie de cimetière » (voir notre introduction ou le chapitre Présences médiévales du livre de Maurice Lévy sur le roman gothique), cette ballade allait développer chez les romantiques l’attrait pour le fantastique morbide. Walter Scott se procura l’original, qu’il traduisit en une nuit ; c’est sa version qui contribua le plus à faire connaître le texte de Bürger et qui influença probablement Coleridge pour Christabel (certainement commencé en 1797 et publié, inachevé, en 1816), dont Byron fit la lecture à ses amis lors du fameux séjour à la villa Diodati et, sans conteste, Southey pour Thalaba the Destroyer (1801), dont certains vers sont la transcription presque littérale de ceux de Bürger. Southey, tout en s’inspirant de Léonora, approche plus fidèlement que Bürger la figure historique du vampire avec le personnage d’Oneiza mais, même s’il semble être le premier romantique à l’avoir introduite dans une de ses œuvres, il n’en reste pas moins que le premier texte littéraire anglais consacré au vampire est celui de John Stagg (voir ci-dessus).
Byron abordera à son tour le thème en 1813 avec Le Giaour tandis que Keats publiera La belle Dame sans merci (1819), où, comme dans le cas de Christabel, de Coleridge, mort et volupté sont inextricablement mêlées, les femmes tuant en même temps qu’elles apportent à leurs victimes – consentantes – le plaisir suprême. Un an plus tard, Keats, se référant à une créature mythologique buveuse de sang, fera paraître un autre poème, Lamia, qui, sans doute mieux que tout autre à l’époque romantique, exprime l’idée de la Femme Fatale, cachant sa nature démoniaque sous une envoûtante beauté – figure reprise entre autres par Le Fanu et Stoker.
Toutefois, en dehors de Stagg, les poètes romantiques anglais n’ont utilisé le thème vampirique que d’une façon allusive et fragmentaire ; de manière générale, on ne peut pas considérer le vampire comme un thème majeur d’inspiration pour la poésie romantique, et même pour la poésie en général, l’effet fantastique en tant que tel n’étant pas recherché dans la grande majorité des cas, le surnaturel n’étant là que pour créer une atmosphère, mais ne constituant pas l’essentiel du message poétique.
Notons que Paul Féval et Bram Stoker citeront chacun un vers de Léonora, l’un dans La Vampire, l’autre dans Dracula, à deux reprises.
Jean Marigny : Le Vampire dans la littérature anglo-saxonne, pages 95-99 et 388-390, cité presque in extenso pour une très large partie de cette fiche. Aussi : Dracula, prince…, page 108. D. S-H., pages 228-229. Fernand Baldensperger : « La Lenore de Bürger dans la littérature française » in Études d’histoire littéraire, Hachette, 1907 (pages 151, 159, mais aussi 148, où F. B. fait remarquer certaines ressemblances entre Léonora et la romance de Berquin, intitulée « Le Pressentiment », parue en 1776. Toutefois, Berquin déclare avoir été inspiré par un extrait d’un poème de Saint-Lambert, paru en 1769). L. D’Hulst, Sur la poésie traduite et ses enjeux au XIXe siècle : Le dossier des traductions françaises de Lénore dans Linguistica antverpiensia, Anvers, 1989, page 57.
* Voir l’introduction de la catégorie « Littérature fantastique ».
** Nous n’avons rencontré en tout qu’un seul autre exemplaire de cette édition (et aucun de la deuxième traduction, publiée en 1814).